étude Donation : explorations de quelques questions juridiques
Démembrement, donation-partage, don manuel
parue dans le guide Legs et Donations 2026

ÉTUDES
Donation : explorations de
quelques
questions juridiques
Démembrement, donation-partage, don manuel
Avant-propos, par
Claude Brenner
Donation d’un droit démembré,
réunion fictive et rapport à succession : analyse critique,
par Hugues Lemaire
Clauses modifiant le rapport
d’un droit démembré
par Hugues Lemaire
Donation-partage et enfant puîné
: une protection sui generis à contrôler et anticiper,
par Alexandre Auriol-Barallotta
Le don manuel de parts sociales
et sa régularisation,
par Paul Tignol et Cassandre Laguarigue de Survilliers
AVANT-PROPOS
Du bon usage des libéralités altruistes
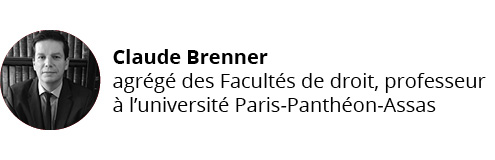
Le Hors-Série Legs et donations que la Semaine juridique notariale édite d’année en année est le vademecum
de la pratique notariale de la philanthropie. Recensant environ 250 associations et fondations reconnues
d’utilité publique, il est un véritable guide de la générosité en France à l’adresse des notaires et de
leurs clients, que viennent enrichir des études techniques intéressant le sujet.
Trois cette année :
• la première, signée Hugues Lemaire, qui est consacrée à une analyse critique du rapport et de la réunion
fictive à succession de la donation d’un droit démembré ;
• la deuxième, rédigée par Alexandre Auriol-Ballarotta, sur le sujet de la protection de l’enfant né après
réalisation par son auteur d’une donation-partage ;
• la troisième, cosignée par Paul Tignol et Cassandre Laguarigue De Survilliers, qui envisage la nullité du
don manuel de parts sociales et les possibilités et implications de sa régularisation.
Ce guide, qui est devenu une référence en la matière, est hautement utile ; d’une utilité qui ne fait que se
renforcer. En effet, si une majorité écrasante de libéralités reste confinée dans le cercle familial le plus
étroit, la philanthropie a gagné beaucoup de terrain en France depuis une vingtaine d’années au moins. Avec
la fin de l’État providence dont la faillite est aujourd’hui consommée, avec le développement de
l’individualisme qui domine désormais la vie économique et sociale et la recherche de sens, les libéralités
philanthropiques ont le vent en poupe. Après les États-Unis et les pays anglo-saxons, le phénomène gagne les
pays continentaux où la redistribution nationale est traditionnellement plus forte : en particulier notre
pays. D’autant que, si l’État n’a plus les moyens de ses ambitions, notamment culturelles et sociales, il
continue d’inciter fiscalement à l’altruisme et la philanthropie. Ce qui contribue significativement au
phénomène. Chez nous de manière raisonnable, peut-on penser. Car le danger est là : que la générosité a
priori la plus pure se mue en technique, plus ou moins opaque, d’évasion fiscale aux mains de grandes
fortunes ainsi que certains systèmes, que l’on a parfois trop tendance à vouloir prendre pour modèle,
paraissent en donner fâcheusement l’exemple.
Ici comme ailleurs, le droit doit donc conserver le sens de la mesure. À ce titre, il est important que
l’État continue d’imposer une organisation juridique de la philanthropie qui soit réellement dominée par
l’intérêt général et soumise à un contrôle public sérieux. Sans doute, ce contrôle est-il de nos jours
excessif et comme le Conseil d’État le suggère depuis des années, des assouplissements de la tutelle
publique en la matière pourraient-ils être bienvenus, encore que la multiplication des structures – les
différentes fondations et surtout la création des fonds de dotation – ont ces derniers temps largement
desserré les contraintes. Ce qui devrait d’ailleurs garder, selon nous, le législateur de succomber à la
tentation, dont certains se font les promoteurs actifs, de consacrer en droit français la
fiducie-libéralité.
Quoi qu’il en soit, le notaire est aujourd’hui très régulièrement confronté au phénomène et il est un acteur
central du mouvement philanthropique, de la bonne orientation de la générosité de ses clients et surtout de
sa bonne organisation juridique.
Ce qui n’est pas forcément facile. Car le droit français des successions et libéralités, à la différence des
droits de common law, n’est pas – du moins traditionnellement – un droit de la liberté de l’individu et donc
de la toute-puissance du disposant, mais une branche du droit de la famille, c’est-à-dire des devoirs de la
personne vis-à-vis de ses enfants en particulier et, de plus en plus, de son conjoint également. En France,
les libéralités philanthropiques doivent ainsi composer avec des contraintes importantes tenant au régime
matrimonial et à la réserve héréditaire en particulier. Des contraintes qu’il est possible de lever de
diverses manières (libéralités avec charges, en démembrement ou en double ligne, notamment), mais avec un
savoir-faire nécessaire dont les notaires sont les dépositaires.
Ce savoir-faire s’apprend largement dans les études, car, faute de pouvoir tout enseigner, l’Université n’y
consacre malheureusement, il faut bien le dire, pas beaucoup de temps. Ce qui est dommage, car la matière
est l’une des plus intéressantes pour la théorie juridique : notamment, elle éclaire remarquablement des
questions fondamentales telle que la notion même de libéralité. Existe-t-elle encore lorsqu’il s’agit
d’exécuter un devoir de conscience ? De favoriser peut-être des inconnus ? Et comment instituer une
fondation non encore existante ? Cela a été l’une des plus instructives controverses et des plus
passionnantes constructions prétoriennes du droit des libéralités. Puis le débat s’est déplacé sur le
terrain de la nécessaire révision des charges souvent stipulées dans les libéralités destinées à développer
leurs effets dans la durée au-delà même de la vie humaine. D’où des interventions successives du législateur
qui ont apporté remède à ces difficultés, d’ailleurs en précurseur : la révision pour imprévision n’a pas
attendu l’ordonnance du 10 février 2016 pour jouer en matière de libéralités avec charges et elle y
fonctionne mieux et plus utilement qu’en droit des contrats à titre onéreux.
C’est dire que cet Hors-Série de la Semaine juridique notariale est particulièrement bienvenu et que sa
double fonction d’annuaire et d’alerte sur certaines difficultés du droit français des successions et
libéralités en lien avec les dispositions altruistes est fort judicieusement conçue. Cela ne signifie pas
que le lecteur doive nécessairement souscrire à toutes les positions critiques adoptées ici ou là. Pour sa
part, le soussigné se fait, par exemple, une tout autre idée de la logique et de l’opportunité du traitement
liquidatif des libéralités en démembrement de propriété que celle qui est très rigoureusement exposée dans
le présent numéro. Mais il appartient naturellement au notaire, comme à tout juriste qualifié, de se forger
son jugement en faisant la part des choses et c’est la mission de l’éditeur d’ouvrir ses colonnes aux
diverses opinions pour que, les difficultés étant mises en évidence comme il se doit, le droit trouve la
voie du juste et du bon par la confrontation des points de vue.